
« Je ne sais pas ce que ça dit, je sais juste ce que j’ai vu. Tu concluras par toi-même: obéir suffit à ma journée. »
(voix du camarade Otto, intendant du Spartak)
Après quarante ans sous terre et vingt-cinq dans les sillons, je devrais jouer aux cartes au chaud en critiquant la pluie. Mais ici, la retraite, c’est un mot sur un papier humide. Le Parti a besoin de moi et, comme toujours, j’obéis. Me voilà chargé de faire tourner ce club de football. Entre nous, ça m’occupe : l’oisiveté n’a pas sa place dans un bourg qui s’écaille.
Le matin, j’ouvre la grille du Centre sportif. La tôle transpire. Je donne un coup d’épaule pour rappeler à la tribune qu’elle tient encore. Ici, tout a un bruit : la tôle chante, le tracteur tousse, le Parti tamponne. Et moi, je fais le reste.
Je commence par les vestiaires. Le carrelage est fendu comme des mains d’agriculteur en hiver. Le robinet du n°2 couine : je cale un seau sous la gouttière. La ligne du rond central est trop pâle : je remets de la chaux. Le Centre des Pionniers sent le caoutchouc pauvre et la vieille chaussette. À l’arrêt de bus, je rescotche l’affiche : « On part à l’heure qu’on a ». Le vent arrache tout ici, sauf la fierté.
Dans ma poche, mon carnet « À faire… pour hier ». En tête : gaz pour la soupe, ampoule tribune, fuite vestiaire, vérifier pompe canal. En traversant le village, je jette un œil : fenêtres bâchées, nids-de-poule profonds comme des souvenirs, murs qui pèlent de rouge syndical sous la pluie. La nuit, on entend tout : les terrils respirer, les chaises traîner, la faim parfois.
Je me souviens de mon premier jour à la mine, j’avais vingt ans. Le contremaître posait sa lampe sur ma poitrine, comme un prêtre pose la main. « En bas, on ne parle pas fort : on travaille fort. » On a appris à obéir à la pelle. Quand la mine a fermé et qu’on s’est retrouvés à cultiver des patates, on a obéi à la bêche. La poussière a changé, pas la cadence. Le Parti aime quand ça file droit.
J’arrive à la buvette et Mémé Irma me sort de mes pensées :
– « Le rideau, camarade Otto ! »
Je fixe le tissu rouge devant la marmite. Sur la table, son précieux carnet de recettes. Je le touche comme une médaille.
– « Tu le mettras à l’abri dans le coffre, hein ? ».
– « Bien sûr, camarade. J’ai reçu plusieurs missives officielles, alors tu penses, je n’oublierai pas », répond Mémé.
Dehors, l’enduit du mur s’effrite comme un croûton trop sec. Derrière la buvette, deux vélos sont adossés. Les lacets orange pendent comme des drapeaux qui auraient oublié leur mât. Par terre, un papier plié. Je l’ouvre sur ma cuisse : croquis de sillons, flèches, petites croix aux arrivées d’eau. Au dos, on distingue les restes d’une affichette déchirée : “Tournoi des Pionniers – inscription au Centre”, logo coupé. Le bord porte une trace de ruban adhésif. Au crayon, un mot raturé : « pot… ». Potager ? Potence ? Impossible à dire. Je glisse le papier dans ma poche, contre ma clé de 13.
Je prends le chemin du canal. Les ronces s’accrochent à mon pantalon. On a bricolé l’irrigation avec des bouts de rien et de la foi. Ici, on fait comme on peut. À la prise d’eau, je découvre un vieux morceau de tuyau et des traces de pneus de vélo. Ce bout de plastique me rappelle l’été 89 : on arrosait les champs à la main, vingt heures par jour. Le Parti nous avait promis un tuyau « soviétique » pour l’été suivant. Il est arrivé en hiver, avec la neige. On a ri, surtout parce qu’il est interdit de se plaindre.
Le clapet de la pompe retarde de sept minutes : pas cassé, juste déréglé. Je l’ajuste avant de ranger le tuyau et de noter les infos découvertes dans mon carnet.
Retour au Centre Sportif. Après une journée aux champs, les Pionniers semblent épuisés et traînent leurs sacs comme des pensées lourdes. Je change un fusible avec la tendresse d’un infirmier. Le soir tombe à la vitesse de l’orage. L’entraînement est terminé, j’ai encore deux ou trois bricoles à réparer. J’aperçois trois ombres près du grillage. Je m’approche sans bruit, mes bottes savent faire. Des bribes glissent jusqu’à moi, entre deux rafales :
– « …la recette… »
– « …samedi, discrètement… »
– « …personne n’a besoin de savoir… »
Je pourrais tousser, pour dire que j’existe. Mais je ne tousse pas. Et je note, comme me l’a demandé la camarade Erika : « Grillage, 20h12 : mots saisis ». Ensuite, je rentre la remorque et éteins la lumière qui aime rester allumée.
Le village est rouillé, oui, mais tenace. Les volets grincent, les pavés boivent l’eau, et les affiches rouges tiennent par habitude plus que par colle. Je me dis qu’il me faudrait demander l’aide de quelques camarades pour remettre tout ça à neuf.
Il y a des soirs où l’on rentre chez soi. Et des soirs où l’on monte l’escalier de la Maison du Peuple. La camarade Erika est là, bureau clair, tampons rangés comme des soldats : EXT-02, P-1989, CPP, M.U.R. Je pose un dossier kraft.
– « Ce que j’ai trouvé. Rien d’autre. »
Elle ouvre, aligne, relie : le croquis de sillons, le bout de tuyau, la retranscription de la conversation.
– « Vous avez bien fait, camarade Otto, » dit Erika.
– « Je ne sais pas ce que ça dit, je sais juste ce que j’ai vu. Tu concluras par toi-même: obéir suffit à ma journée. »
Ses yeux sourient. Ses mains, non. Elle classe méticuleusement mes découvertes dans un dossier déjà bien fourni. Je sors. Le couloir sent la cire et l’autorité. Je démarre le vieux tracteur, le moteur couvre le bourdonnement de la Maison du Peuple. La radio grésille : météo, puis une marche militaire qui n’impressionne que les pigeons.
Encore une journée qui se termine. J’ai connu pire : la mine sans air, la terre sans pluie. Bonne nuit, Kartoffelgrad. À l’aube, on recommence le refrain.
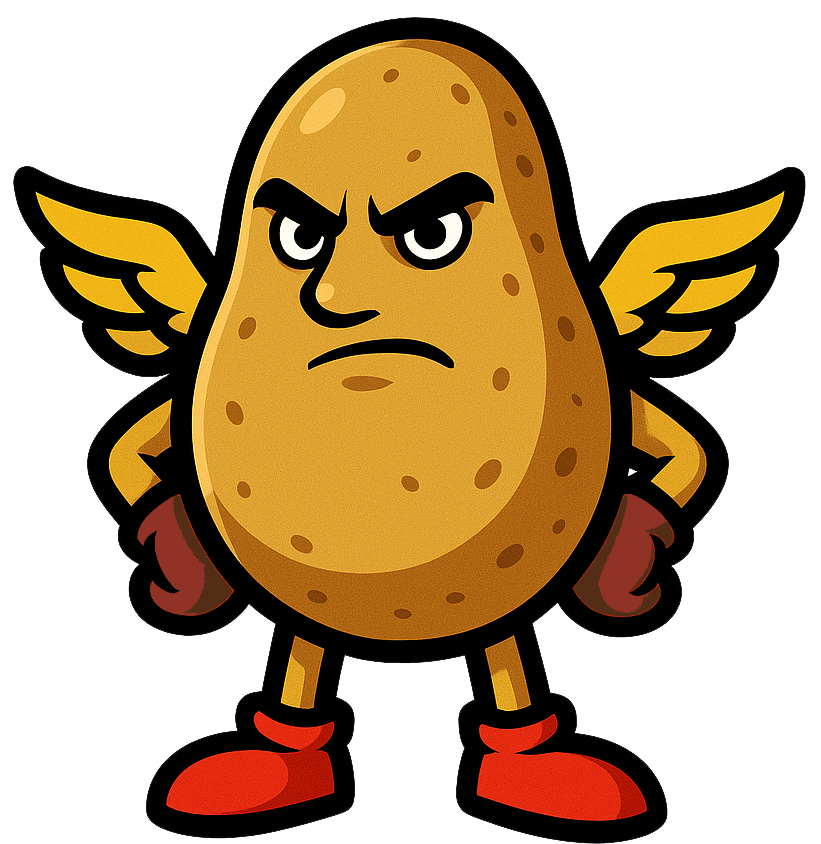
Laisser un commentaire